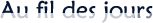Actualité du Dimanche 06 Novembre 2005 à 20h30
CONCERT MANCA 2005 - Pierre Jodlowski ‘‘Ciné-Concert‘‘
Dimanche 6 novembre 2005, 20h30 - Espace Magnan, Salle Jean Vigo (Nice).
Ciné/Concert
LA GREVE
Musique et diffusion électroacoustique
de Pierre Jodlowski
sur le film de Sergei Mikhalovitch Eisenstein
1h40
Commande de la création musicale de la Cinémathèque de Toulouse à Pierre Jodlowski.
Collaboration Cinémathèque de Toulouse / Mission Cinéma de l’Espace Magnan / CIRM.
Ce concert entre dans le cadre de la programmation « Cinéma des Utopies » de la Mission Cinéma de l’Espace Magnan, qui projette d’autres films de S.M. Eisenstein, en compagnie de spécialistes du cinéma.
Technique CIRM
Spectacle filmé par la Mission Cinéma de l’Espace Magnan
Fin du spectacle 22h30
Après le premier film de Vigo, le premier film d’Eisenstein. C’est Pierre Jodlowski, compositeur familier du CIRM (il a répondu à une commande en 2003 pour trio et technologie) qui a travaillé sur ce film de 1924. Les grandes innovations du langage cinématographique du cinéaste sont déjà présentes dans ce « cinéma-poing » selon son expression, en particulier dans le domaine du montage, élément particulièrement déterminant pour un compositeur travaillant sur l’image. À propos de Vigo, il s’agissait de dialogue entre le son et l’image, pour Eisenstein, il s’agit plutôt d’une série de trajectoires et d’amplifications comme le précise le compositeur : « Mettre ce film en musique ne consiste pas simplement à combler un silence (d’ailleurs, Eisenstein le fait très bien tout seul !) mais plutôt à tisser des trajectoires, à renouveler l’espace de la projection dans une dimension sonore. »
Eisenstein / Vigo, deux cinéastes de référence pour la programmation du « Cinéma des Utopies », occasion pour le CIRM d’entamer une première collaboration avec la Mission Cinéma de l’Espace Magnan de Nice.
Pierre Jodlowski, compositeur (Toulouse, 1971)
Pierre Jodlowski a obtenu un Premier Prix de Composition au département SONVS du Conservatoire National de Lyon en 1996. L’année suivante, il est admis au cursus de composition et d’informatique musicale de l'IRCAM. À partir de 1998, il s’attache au développement du projet S.A.M - Structure d’Action Musicale - visant à la promotion des musiques d’aujourd’hui en région toulousaine : fondation d'un studio de recherche et de création et, lancement du festival “Novelum”, entièrement consacré aux arts sonores d’aujourd’hui. Titulaire du C.A. d'électroacoustique, il développe également une importante activité pédagogique. Il enseigne actuellement à l’Université de Toulouse ainsi qu’à l’École d’Ingénieurs Supaero. Dans son travail, Pierre Jodlowski s’attache à associer l’écriture instrumentale aux possibilités électroacoustiques et s’intéresse à l’ouverture vers d’autres formes artistiques, comme la danse, le théâtre et les domaines de l’image. Depuis 1999, il se consacre essentiellement à la composition grâce à des commandes de l’IRCAM, de L’Ensemble Intercontemporain, du Ministère de la Culture, du CIRM, du festival de Donaueschingen...
Lauréat de plusieurs concours internationaux (Gaudeamus, Bourges, Luigi Russolo, IRCAM / E.I.C.), il a obtenu le Prix Claude ARRIEU de la SACEM en 2001.
La grève
Musique sur le film de La grève de Sergei Mikhailovitch Eisenstein
Musique électroacoustique
Ce premier film d’Eisenstein pose d’une certaine façon les bases du langage du cinéaste russe en rejetant d’emblée la notion d’un cinéma d’acteurs, pour se préoccuper plus fondamentalement d’un art de l’image, au travers du montage et de la construction formelle. La portée politique du film, si elle reste indéniable (on parlera du cinéma soviétique de cette époque en termes de propagande), s’estompe au profit d’un travail où les enjeux purement artistiques prédominent. C’est tout du moins la perception que j’ai pu avoir de cette œuvre, dès le premier visionnement, où les questions de rythme, d’articulation et de gestes m’ont semblé à l’origine même de l’organisation temporelle et visuelle. La Grève reste pour moi un tableau ; tableau en mouvements, où le noir et le blanc deviennent couleurs, où la force d’une séquence est indissociable du tout, dans sa pertinence structurelle. La Grève, film muet, se détache ainsi de la parole, véhicule les symboles d’un monde bouleversé, transmet, jusqu’à aujourd’hui, et c’est là sa force, les questionnements de l’homme, le sens même de l’existence.
Pourtant, c’est par la dynamique de l’image, les contrastes prononcés du rythme des séquences, la mise en scène excessive (devenant allégorie) qu’une dimension philosophique peut naître et non pas par une simple mise en image d’acteurs ou d’histoires charismatiques (comme le cinéma peut le faire bien souvent aujourd’hui). On voit bien alors comment l’idée musicale peut naître dans l’esprit du compositeur : la musique est art du temps et de l’espace, du rythme et de la forme. Mettre ce film en musique ne consiste pas simplement à combler un silence (d’ailleurs Eisenstein le fait très bien tout seul !) mais plutôt à tisser des trajectoires, à renouveler l’espace de la projection dans une dimension sonore. Là est le projet de cette création : apporter un nouvel “éclairage” de l’œuvre cinématographique à travers une musique dont l’intensité rivalise avec celle du film, induire un rapport de forces, concentriques ou divergentes, retrouver l’énergie de l’image pour mieux la déconstruire et en donner une “interprétation” sensible.
Sergei Mikhailovitch Eisenstein, cinéaste (URSS, 1898-1948)
Eisenstein est issu d’une famille de notable : père conseiller d’état et ingénieur - mère appartenant à la grande bourgeoisie marchande de Saint-Pétersbourg. Après avoir suivi la voix paternelle, Eisenstein qui se passionnait déjà pour les arts plastiques, s’inscrit aux cours des beaux-arts de Riga. En 1917, la guerre civile éclate : alors que son père s’engage dans l’armée blanche tsariste, lui rejoint les rangs de l’armée rouge. C’est évidemment un grand tournant dans la vie d’Eisenstein qui voit dans la rencontre de l’art et de la révolution la possibilité d’accomplir sa liberté individuelle. Après ce passage déterminant aux beaux-arts et au théâtre avec Meyerhold (figure puissante du théâtre moderne et l'un des fondateurs du théâtre d'art et de la mise en scène) Eisenstein réalise, en 1924, la Grève, avec le collectif du « théâtre du peuple » (Proletkult). Le film est très remarqué et dès l’année suivante, pour célébrer le vingtième anniversaire des événements de 1905 (…), le Parti communiste de l’Union soviétique décide de produire plusieurs longs métrages dont le Cuirassé Potemkine qui va rendre célèbre Eisenstein dans le monde entier.
En 1926, Eisenstein met en chantier la Ligne générale, sur le thème de la collectivisation des campagnes, film dans lequel apparaît pour la 1ère fois, le héros individuel. Le cinéaste interrompt la production de ce film pour apporter sa contribution au 10ème anniversaire de la révolution de 1917, avec Octobre, puis achève "la Ligne générale". Mais le film est critiqué : on lui reproche de pratiquer un cinéma intellectuel en abusant des symboles, en utilisant des métaphores, ce qui a pour effet d’éloigner le peuple de ses films. On lui demande aussi, suite à l’exclusion de Trotski du parti, de couper toutes les scènes où ce dernier apparaît. Eisenstein entre dans une période de doute et décide de prendre un peu de recul en parcourant le monde pour une série de conférences. Il travailla quelques mois à Hollywood, puis s’établit au Mexique pour y réaliser avec Tissé et Alexandrov une nouvelle et gigantesque épopée (1929-1931). Une mauvaise période commença alors pour lui : avant d’être terminé, Que viva Mexico lui fut enlevé et il ne put jamais tenir en main ses négatifs pour construire, par le montage, un monument filmique qui aurait peut-être surpassé Potemkine. C’est profondément déçu, qu’en 1932, Eisenstein retrouve le chemin de l’URSS et des studios soviétiques où il mène des activités d’enseignement à l’école de cinéma nationale (VGIK). C’est là, qu’il va élaborer une oeuvre théorique considérable, une réflexion globale sur le cinéma donnant lieu à des ouvrages de plusieurs milliers de pages (3900 pages).
En parallèle, il conçoit la mise en scène d’un nouveau film - Le Pré de Béjine – qui sera définitivement interrompu en mars 1937 sur ordre du responsable à la propagande. Eisenstein doit, une nouvelle fois, faire amende honorable et, pour retrouver sa place dans le cinéma soviétique, il propose une épopée nationale dans le goût du réalisme socialiste, Alexandre Nevski. Le film est un immense succès et ce retour en grâce lui permet alors de songer à une épopée fleuve, Ivan le Terrible. La première partie (tournée de 1942 à 1944) présente, non un tyran assoiffé de sang, mais un héros russe victorieux, soit tout ce dont l’URSS avait besoin en ces années de guerre. La deuxième partie (tournée en 1945 et 1946) montre le tsar régnant désormais par la terreur absolue. Allusion trop transparente à l’actualité ? Cette partie est interdite comme étant "historiquement incorrecte" et le demeurera jusqu’en 1958. La troisième partie ne verra jamais le jour, d’autant plus qu’Eisenstein est frappé par la crise cardiaque qui, finalement, l’emporte à l’âge de 50 ans.
Ses films ont une influence considérable sur le cinéma et l’évolution de son langage, notamment sur le plan du montage. Murnau, Sternberg, Gance, Cocteau... et plus proche de nous Robert Bresson, Alain Resnais et Jean-Luc Godard, ces cinéastes pour qui le montage est le fondement même de l’écriture cinématographique.
La grève (1924) URSS, film muet
Noir et blanc - 73minutes
Scénario : S.M. Eisenstein, Valeri Pletnev & Gregory Alexandrov.
Photographie : Edouard Tissé & Vassili Hvatov. Production : Goskino. Interprétation : Ivan Kljuvkin, Alexandre Antonave, Grogori Alexandrov.
Une usine en Russie au début du siècle. Tout est calme, le patron est souriant. Un groupe de militants prépare une grève. Un contremaître les dénonce et le gouverneur militaire engage des indicateurs pour les espionner. La grève est cependant déclenchée après le suicide d’un ouvrier accusé injustement de vol. Le patronat organise la riposte, la grève se prolonge. La police fait appel à la pègre pour monter une provocation. L’assaut final est donné : c’est une véritable « boucherie ». Ce film, le premier d’Eisenstein, porte et développe déjà les théories du cinéma sur le montage. La Grève est une révolution cinématographique enlevée par la fougue, l’audace et la liberté du jeune réalisateur.